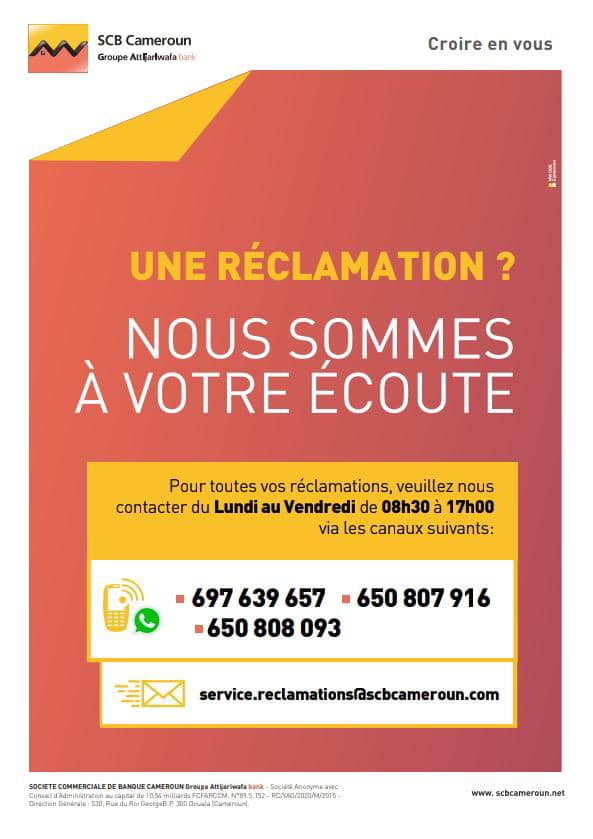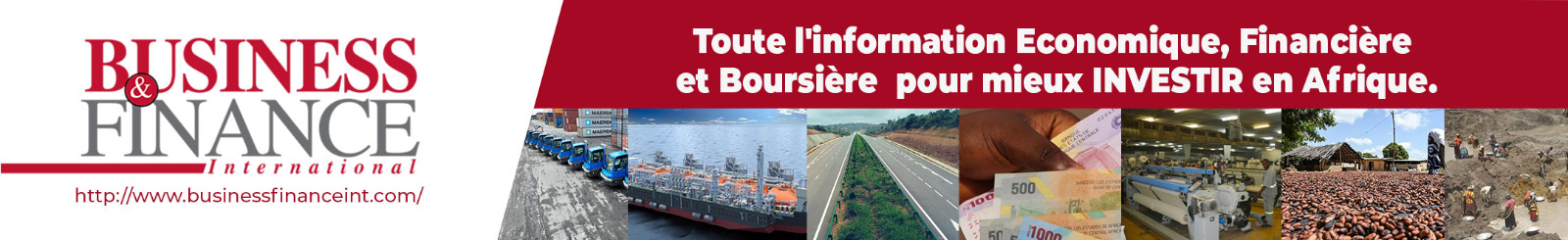(BFI) – Loin des prédictions fatalistes sur l’Afrique, cet expert appelle à un véritable sursaut pour relancer le système alimentaire mondial.
La Faim du monde : Nasser Brahimi, écrivain et expert international auprès d’agences et de programmes des Nations unies, aime les jeux de mots. En écrivant ce livre destiné à tous, son objectif est simple : nous aider à mieux comprendre les mécanismes responsables de l’insécurité alimentaire. Il dépeint les ravages de l’homme sur la nature, les implications sur la production alimentaire et les inégalités économiques qui accentuent la faim. Aujourd’hui, alors que la pandémie du Covid-19 met en évidence la vulnérabilité des systèmes de production et de distribution des denrées alimentaires, il explique en quoi ce moment est précieux pour tout repenser. Nasser Brahimi s’est confié au confrère du Point Afrique.
Dans votre livre La Faim du monde, vous décrivez dans une première partie toutes les causes qui mènent à l’insécurité alimentaire et la fin de la vie sur Terre. Parmi ces causes, vous désignez le braconnage et le trafic de viande de brousse. Justement, la consommation de pangolin fait partie des hypothèses de transmission du Covid-19 de l’animal à l’homme. Pouvez-vous décrire les ressorts de ce trafic et de ses dangers ?
En effet, cette première partie du livre fait craindre le pire, je l’admets. Il fallait bien attirer l’attention sur les risques réels de la manière de vivre notre planète, en charmante compagnie de la faune sauvage et de la flore. Quel genre de coexistence veut-on ? L’homme n’a cessé d’occuper l’espace réservé à la flore et la faune sauvage. Des régions autrefois vierges et inhabitées, où vivaient de nombreuses espèces, se trouvent fragilisées. Loin de notre vision bucolique, les paysans africains éprouvent peu d’empathie pour la faune et voient plutôt les animaux sauvages comme de la viande, source de protéines. D’ailleurs, dans plusieurs langues bantoues, le mot nyama, utilisé pour désigner la faune, signifie aussi viande de brousse.
Cependant, le braconnage des espèces sauvages est le quatrième marché illégal au monde, après la drogue, la contrefaçon et le trafic de migrants. En lieu et place d’une chasse durable, le braconnage et le commerce illicite d’espèces et de plantes sauvages sont un crime qui saigne la faune et la flore de ces pays, prive les populations autochtones de leur patrimoine. Il n’a pour seul but que d’enrichir les trafiquants et leurs complices locaux. Il rapporterait de 7 à 23 milliards de dollars par an. Mais aussi l’exploitation illicite de la faune peut compromettre la santé humaine et animale à travers la propagation des maladies virulentes, comme le Covid-19.
La pandémie du Covid-19 a poussé nombre de pays à prendre des mesures jamais observées à cette échelle planétaire : confinement, couvre-feu… Quels impacts le Covid risque-t-il d’avoir sur la sécurité alimentaire en Afrique, le continent déjà le plus touché par l’insécurité alimentaire ? Quelles sont les conséquences possibles dans les zones rurales et dans les villes ?
En Occident, on voit des files interminables de nécessiteux en train de faire la queue pour un plat chaud. Au Sud, certains régimes ont profité de ce couvre-feu sanitaire-militaire pour donner un sacré tour de vis. On a assisté à un formidable renforcement des régimes militaro-policiers : contrôle total d’Internet, interpellations et emprisonnement des contestataires (pourtant tous pacifiques).
L’Afrique n’a pas attendu le Covid-19 pour souffrir. Là, il ne s’agit pas de choisir qui sauver, mais qui nourrir. La situation s’est aggravée du fait de cette pandémie, mais, Dieu merci, le continent semble être épargné du pire. Déjà, l’Afrique importe presque tout ce qu’elle consomme, alors qu’elle possède les deux tiers des terres arables de la planète. L’ONU indique que, parmi les effets multiples du Covid-19 sur les activités économiques et sur les chaînes d’approvisionnement, on constate une augmentation des prix des denrées alimentaires, ce qui pénalise davantage les plus démunis et réduit l’accès des ménages aux denrées alimentaires de base. Les exploitants agricoles sont eux aussi confrontés à des difficultés croissantes pour produire, faute d’intrants, de mobilité de la main-d’œuvre, etc., ce qui à terme pourrait sérieusement fragiliser leurs moyens de subsistance. On est déjà dans une situation d’urgence. Avant la pandémie, 135 millions de personnes dans le monde subissaient déjà une faim aiguë, à cause de guerres, de conflits armés, de chocs climatiques et de récessions économiques, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires de 2020. Près de 183 millions de personnes pourraient glisser dans la faim extrême.
Les enfants sont aussi victimes du Covid-19 ! On y pense moins, mais l’interruption de l’école les a privés d’un espace sûr et d’une ration alimentaire par jour. En Irak, au Soudan, en Syrie et au Yémen, les campagnes de vaccination contre la polio ont été interrompues, selon l’Unicef. En Irak, au Liban, au Yémen et à Djibouti, aucun vaccin contre la rougeole n’est en cours en ce moment.
À ces risques sur la sécurité alimentaire liés au Covid s’ajoute l’invasion de criquets en Afrique de l’Est, et qui risque maintenant de se propager vers l’Afrique de l’Ouest. Comment les pays peuvent-ils se préparer pour faire face ?
C’est vrai, comme si cela ne suffisait pas ! L’Afrique est confrontée, aujourd’hui, à une invasion de criquets pèlerins plutôt sévère. C’est une crise sans précédent sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance qui se poursuit dans la Corne de l’Afrique. À chaque invasion acridienne, la FAO, en chef de file, organise et coordonne la lutte contre les criquets pèlerins (Schistocerca gregaria). J’en sais quelque chose, car j’ai participé à la gestion de crises précédentes. Lors de la recrudescence acridienne de 1988, ils ont réussi à traverser l’océan Atlantique de la Mauritanie jusqu’aux Caraïbes, parcourant 5 000 kilomètres en 10 jours ! Non seulement les essaims se posaient sur tous les navires, mais aussi sur les vagues. Les premiers se noyaient, mais leurs cadavres servaient de radeaux aux autres. Ces insectes voraces dévorent tout sur leur passage et ne laissent derrière eux qu’un sillage de tristesse et de désolation. La situation risque de s’aggraver. Selon les experts de la FAO, l’invasion s’étendra probablement à l’Asie du Sud-Ouest et peut-être à l’Afrique de l’Ouest. Comme ça, la boucle est bouclée !
Quelles sont les leçons à tirer de cette pandémie et les esquisses de solutions possibles, que vous évoquez notamment dans la dernière partie de votre ouvrage La Fin de la faim ?
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la santé est passée avant l’économie. On en connaîtra l’étendue des conséquences dans les mois à venir. C’est un exemple de changement de cap, nécessaire, vital, opéré par l’humanité entière. Et si cette prise de conscience pouvait accélérer la transition écologique avec la considération et donc l’acceptation des problèmes environnementaux, la recherche de solutions et leur mise en pratique. On redécouvre une agriculture de proximité et de qualité, plus respectueuse des cycles naturels et de la chaîne de valeur allant du producteur au distributeur. L’idéal est de manger mieux, moins et diversifié. Beaucoup de scientifiques voient comme solution l’application de l’agroécologie, qui consiste à appliquer des principes écologiques de manière à optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l’environnement, sans oublier les aspects sociaux dont il convient de tenir compte pour que le système alimentaire soit durable et équitable. L’agroécologie permettra de restaurer les services écosystémiques et la biodiversité de manière saine.
Bien sûr, certaines voix se demandent comment nourrir le monde si on ne booste pas l’agriculture avec des pesticides. Certes, ils ont apporté beaucoup de choses à la société : ils ont allégé le travail des agriculteurs, multiplié les rendements et permis d’atteindre l’autosuffisance alimentaire de nombreuses régions du monde. Mais, avec le temps, on a appris que les pesticides tuaient les abeilles, faisaient disparaître les oiseaux et déclenchaient des maladies graves chez leurs utilisateurs. Tout ça n’est pas rien comme prix à payer ! Avec le temps, on a appris que les fabricants de pesticides gagnaient des montagnes d’argent. Ils sont capables, en dehors de toute morale et de toute honnêteté (j’ajouterais en toute légalité), de soudoyer des scientifiques pour qu’ils publient des rapports complaisants et qu’ils trompent l’opinion publique. Et la dépendance publicitaire des médias n’arrange pas non plus les choses. La prise de conscience se renforce de jour en jour. Ce tsunami, la pandémie, a révélé de nombreuses vérités sur notre mode de vie et d’alimentation. Il est encore tôt pour le réaliser, mais je suis persuadé que plus rien ne devrait être comme avant. D’une manière générale, le système alimentaire actuel est à la fois dangereux pour l’humain, toxique pour l’environnement et injuste, car producteur d’inégalités, de pauvreté, de dépendance.
Le Point Afrique