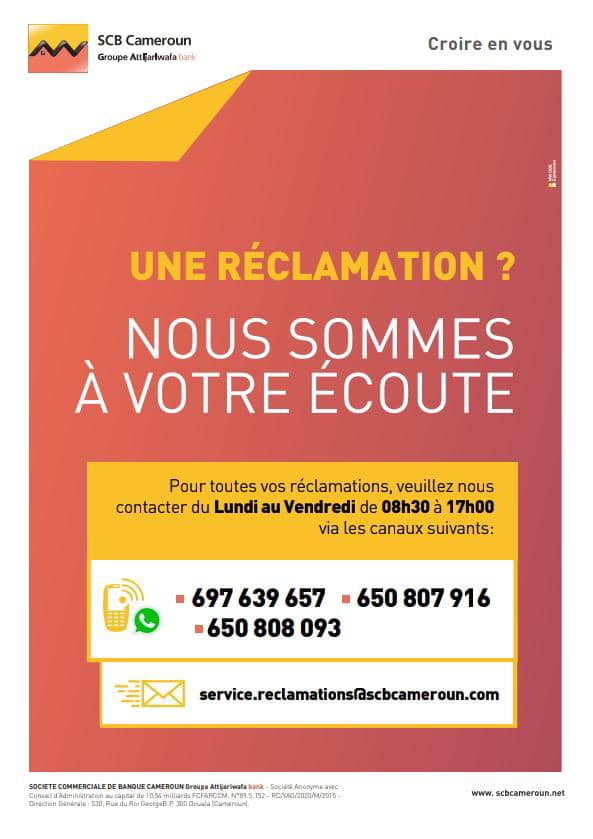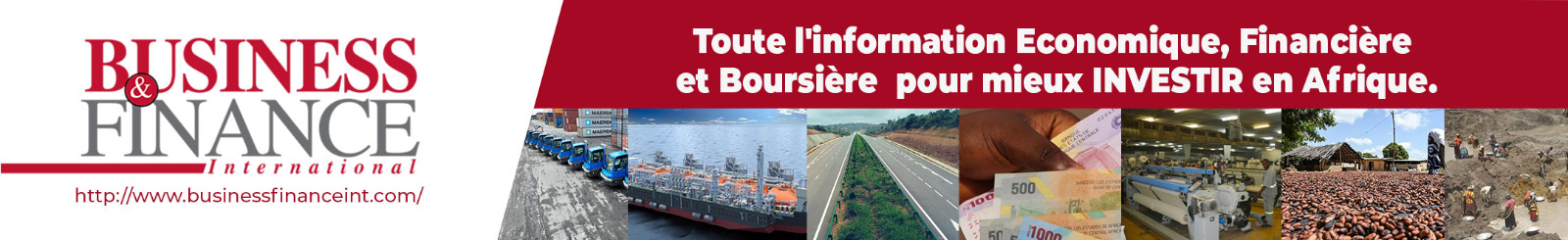(BFI) – Début juillet, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé que le Gabon n’attribuera plus de bourses d’études vers la France, les États-Unis ou le Canada à compter de 2026. Un mois plus tôt, le Nigeria a suspendu pour cinq ans le programme BEA (Bilateral Education Agreement), un dispositif de coopération académique bilatérale avec plusieurs partenaires. En 2024 déjà, le gouvernement de Bola Tinubu avait supprimé le financement de la formation de ses chercheurs et universitaires à l’étranger. Ces décisions relancent un débat latent sur le rôle réel des bourses internationales dans le développement des pays africains. Sont-elles devenues un investissement à perte pour les États du continent ou un levier stratégique mal exploité ?
Longtemps perçues comme un symbole de réussite, les bourses d’études à l’étranger ont permis à de nombreux jeunes Africains d’accéder à un enseignement de qualité et à une ouverture sur le monde. Elles servent de tremplin social et professionnel, notamment dans les disciplines scientifiques, médicales ou techniques. Pourtant, ces parcours d’excellence débouchent rarement sur un retour au pays. L’UNESCO alerte que l’Afrique forme chaque année des milliers de chercheurs qui finissent par travailler ailleurs. Selon l’OMS, environ un quart des médecins formés sur le continent exercent aujourd’hui à l’étranger.
Les gouvernements financent ainsi des talents qui, pour des raisons souvent rationnelles, mettent leurs compétences au service d’autres économies. Les coûts sont colossaux. Un rapport de la CNUCED, publié en 2023, estimait à près de 4 milliards de dollars par an les pertes liées à la fuite des cerveaux, une somme qui inclut les investissements publics en éducation et les manques à gagner dans les services de santé, la recherche ou l’administration. Cette réalité alimente la frustration dans les cercles politiques. Au-delà des considérations budgétaires, cette situation reflète également un déséquilibre structurel, marqué par une migration des compétences vers les pays du Nord, tandis que l’accès à leurs marchés reste parfois restreint.
Des conditions de retour peu attractives
Revenir travailler sur le continent après des études à l’étranger reste, pour beaucoup, un choix difficile. Le premier frein est souvent économique. Le différentiel salarial est flagrant. Selon les données disponibles, un médecin spécialiste peut espérer gagner entre 7000 et 9500 dollars mensuels en Amérique du Nord ou en Europe, contre environ 400 à 600 dollars dans plusieurs États d’Afrique de l’Ouest ou du Centre. Un ingénieur diplômé peut prétendre à 4500 dollars par mois en début de carrière dans les pays industrialisés, alors qu’il dépassera rarement 1000 dollars dans les économies africaines. Un enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat gagne entre 500 et 800 dollars par mois dans les universités publiques locales, contre 3 500 à 6 000 dollars à l’étranger.
Au-delà des écarts de revenus, les conditions de travail dans plusieurs secteurs publics africains restent un frein majeur à la rétention des talents. Dans un quick publié en juin 2025, Wathi, un think tank sénégalais, souligne que les universités ouest-africaines sont régulièrement confrontées à des coupures d’électricité, à des équipements vieillissants et à des budgets de recherche insuffisants. Les enseignants-chercheurs doivent souvent gérer des classes surchargées, sans accompagnement suffisant, ce qui dégrade leur quotidien professionnel et personnel.
Le secteur de la santé n’échappe pas à ces difficultés. Les hôpitaux manquent de matériel, et les infrastructures sont généralement sous-dimensionnées, créant un environnement de travail stressant pour le personnel. Au Bénin, une étude quantitative menée en 2022 montre que, dans certaines régions, les infirmiers exercent encore dans des conditions difficiles, avec parfois des équipements insuffisants et un système de santé sous tension.
Par ailleurs, le marché africain de l’emploi peine à absorber les profils qualifiés. Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, le taux de chômage des jeunes diplômés dépasse 30 %, avec un taux de sous-emploi bien plus élevé encore, selon l’OIT (2023). Même dans les secteurs stratégiques comme la santé ou le numérique, les opportunités sont limitées, souvent mal rémunérées ou concentrées dans les grandes agglomérations. Dans ce contexte, retourner au pays devient un pari personnel risqué, bien plus qu’un choix de carrière logique.
Repenser les offres de bourses sans y renoncer
Faut-il pour autant supprimer toutes les bourses et fermer les frontières éducatives ? Certainement pas. La mobilité académique peut rester un atout, à condition d’être encadrée et pensée dans une logique de retour ou de transfert de compétences. Ce n’est pas la mobilité en elle-même qui pose problème, mais l’absence de stratégie nationale claire pour valoriser les retombées de cette mobilité. Le débat ne devrait pas se réduire à une opposition entre ouverture et repli, mais interroger le sens et les finalités des politiques de formation.
Des alternatives concrètes existent pour sortir de cette impasse. Le renforcement des centres de formation locaux permettrait de retenir les talents tout en assurant une montée en compétence. Des partenariats avec des universités étrangères peuvent aussi produire des effets positifs sans exil académique prolongé, notamment à travers des diplômes co-délivrés, des stages croisés ou des mobilités courtes. Ces modèles hybrides sont en plein essor dans certains pays, où des programmes d’incitation au retour encadré sont en place depuis plusieurs années.
D’autres États expérimentent des bourses conditionnelles. Dans ces dispositifs, les bénéficiaires s’engagent contractuellement à revenir exercer pendant un nombre d’années défini, souvent dans le secteur public. Par exemple, au Rwanda, certaines bourses médicales incluent une obligation de service dans les hôpitaux publics à l’issue de la formation. Au Ghana, des dispositions similaires s’appliquent aux programmes postdoctoraux financés par l’État ou des universités publiques.
Ce contrat moral et financier vise à garantir un retour sur investissement pour les pays émetteurs, qui cherchent à limiter la fuite des cerveaux. Par ailleurs, la mobilisation de la diaspora constitue une ressource stratégique. Le programme « Transfer of Knowledge Through Expatriate Nationals (TOKTEN) », mis en œuvre avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), facilite la contribution des talents installés à l’étranger sans exiger leur retour définitif. Des professionnels s’investissent ainsi via des missions ponctuelles, du mentorat à distance ou des projets collaboratifs avec des institutions locales. Plusieurs gouvernements ont également mis en place des plateformes de coopération scientifique avec leur diaspora pour encourager le transfert de compétences dans les domaines clés comme la santé, les technologies ou l’enseignement supérieur.
Vers une stratégie continentale cohérente
Ces pistes, loin d’être idéales ou parfaites, ouvrent néanmoins un horizon plus cohérent. L’enjeu n’est pas de rompre avec le monde, mais de mieux définir les termes de l’échange. L’Afrique ne peut pas continuer à investir dans des formations qui bénéficient principalement à d’autres. Elle doit penser la formation comme un outil de souveraineté, pas seulement comme une opportunité individuelle.
Le virage opéré récemment par plusieurs États est radical, mais il met en lumière une nécessité. Tant que le continent ne créera pas les conditions du retour, les bourses d’études resteront un passeport vers l’exil. Repenser les bourses, ce n’est pas s’en passer, c’est les arrimer aux besoins du continent et réconcilier ambition personnelle et intérêt collectif.
In Ecofin