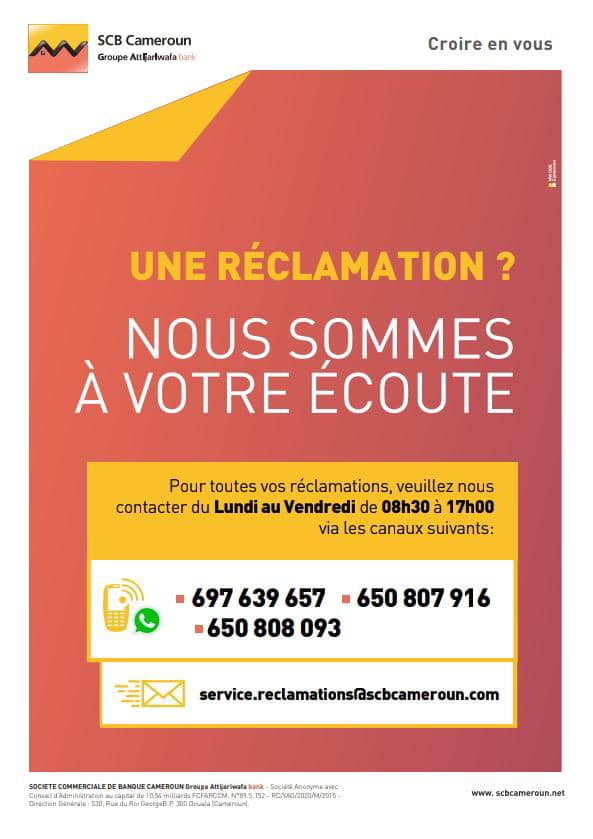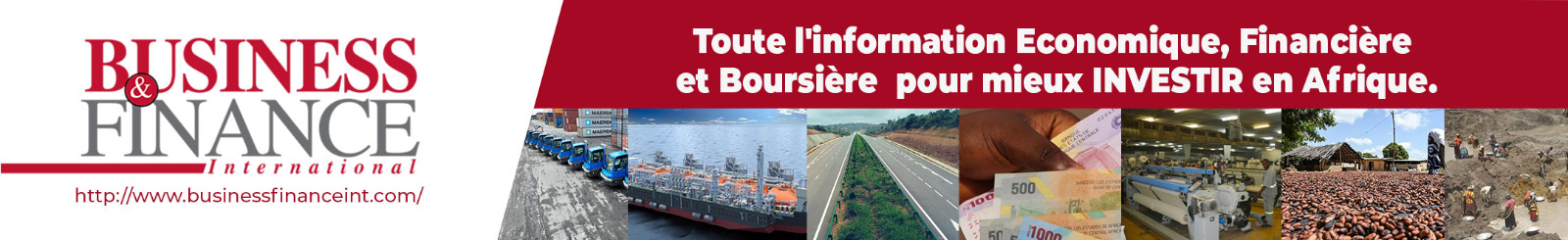(BFI) – Pour la déployer de manière juste et optimale dans sa structuration et ses choix d’investissements, la finance verte devra s’appuyer sur des places qui ont déjà fait leur preuve.
De la COP 23 au One Planet Summit, le grand rassemblement sur le climat qui s’est tenu mi-décembre à Paris, la « finance verte » aura rythmé l’agenda international de la fin d’année 2017. Les différents appels au déblocage des fonds à destination des zones qui en ont le plus besoin éclairent l’urgence qu’il y a à faire émerger de nouvelles organisations financières comme le Green Climate Fund (GCF). Les dirigeants réunis pour le One Planet Summit ont d’ailleurs exprimé la volonté que les fonds levés soient prioritairement investis sur des territoires très exposés aux effets du changement climatique où s’imposent, à court terme, des mesures d’adaptation ou d’atténuation, en particulier, les pays africains et les petits états insulaires en développement.
Ces systèmes de financement, selon leurs promoteurs, devraient devenir dès que possible aussi massifs et attractifs, si ce n’est plus, que ceux qui soutiennent encore aujourd’hui les autres pans de l’économie, notamment les secteurs associés aux usages polluants des hydrocarbures qu’il s’agit de faire reculer. Pour relever ce défi, on attend de la part de ces outils financiers innovants – et des artisans qui les mettent en œuvre – des formes d’agilité extrême et de précision quasi chirurgicale.
Maurice : une bonne base pour déployer la finance verte
De fait, des plateformes comme Maurice, qui font chaque jour leurs preuves en termes de stabilité, de compétences et de performances pour la gestion des flux orientés vers ces territoires, ne devraient pas être fragilisées à cause d’un classement – avec 46 autres pays – sur une liste établie de manière contestable par l’Union européenne. Le Centre financier international de Maurice (où sont appliqués les protocoles d’échange d’information automatique établis par l’OCDE et les USA) peut fortement contribuer à un déploiement juste et optimal de la finance climatique dans les pays de l’océan Indien et en Afrique.
La démonstration de son efficacité est d’ailleurs faite, par nulle autre que l’Agence française de développement dont on connaît l’engagement pour la transparence. Dix ans après son retour à Port Louis, l’AFD a lancé, via l’agence régionale Maurice-Seychelles, avec le concours d’établissements financiers mauriciens et à destination de projets développés sur ses divers territoires, la troisième tranche de SUNREF, son label de finance verte.
Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
Au-delà de l’actualité sur la finance verte, et même si des améliorations sont sans doute à attendre de la part d’opérateurs en activité dans les centres comme celui de Port-Louis, j’aimerais surtout, à propos de nos jeunes plateformes, qu’on ne jette pas le bébé avec l’eau du bain. En effet, dans des pays où la levée de capitaux en Bourse est encore en phase de démarrage et où le coût du crédit demeure très élevé, les apports en fonds propres se révèlent des instruments favorables à la croissance, à l’emploi et au développement durable des économies émergentes.
Principal gisement de revenus en Afrique, l’entrepreneuriat a besoin d’investisseurs en capital. Pour ce type d’outils, la juridiction mauricienne est un hub idéal. Par exemple, en 2014, la Banque africaine de développement était déjà présente dans le capital de 482 compagnies, de différentes tailles, opérant dans 34 pays et dans différents secteurs, à travers 37 fonds dont les gestionnaires ont choisi d’utiliser la plateforme mauricienne pour les décaisser et les réinvestir.
La bonne gouvernance, les garanties et le professionnalisme que l’un des principaux partenaires financiers au développement en Afrique a trouvé à Maurice se révèlent encore plus utiles aujourd’hui. Et alors que l’Afrique a définitivement intégré les radars des investisseurs internationaux, pas moins de 226 milliards de dollars US de flux financiers ont pris la direction du continent en 2016. Ceux-ci ont besoin des services de gestionnaires qui maîtrisent des flux transfrontaliers, soumis à une fiscalité raisonnable et cohérente, dans un environnement politique et juridique stable, et bénéficiant d’accords établis avec d’autres pays africains, où ces fonds sont investis.
Jeter le doute sur les places financières qui ont fait la preuve de leur volonté de coopérer avec les régulateurs internationaux, c’est prendre le risque de priver l’Afrique de sources d’investissement prometteuses et, je le crains, à terme, de financements essentiels pour réaliser les projets indispensables à l’adaptation aux changements climatiques dont elle est disproportionnellement victime.
Par Richard Arlove, Directeur général d’Abax, prestataire international de services fiduciaires, de conseil et d’affaires, basé à Maurice.