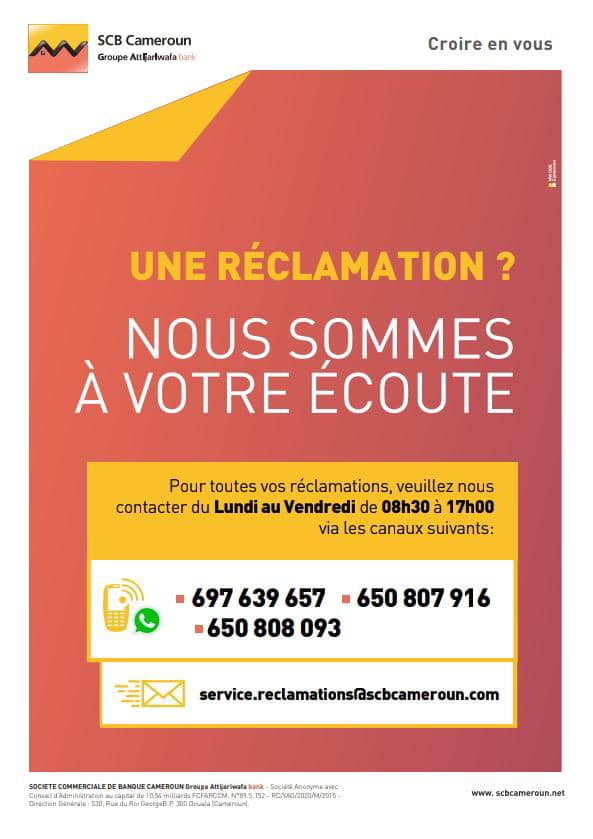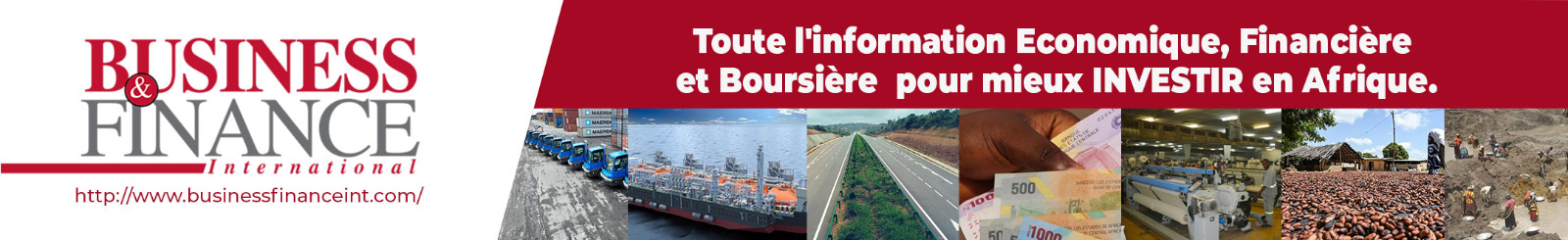(BFI) – Entre 2018 et 2022, les recettes fiscales issues du pétrole ont constitué un pilier majeur du budget du Cameroun. Selon les rapports successifs de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), le pays a engrangé environ 1020 milliards de Fcfa sur cette période grâce à une série de réforme fiscale et à la digitalisation des recouvrements.
En 2018, les recettes pétrolières s’élevaient à 120 millions de Fcfa, soit 22% des recettes fiscales totales. L’impôt sur les sociétés (IS) pétrolière, ceux prélevé sur les bénéfices des entreprises exploitant le pétrole, était la principale composante. Ces montants, encore modestes, marquaient le point de départ d’une tendance haussière alimentée par une meilleure gouvernance et des transferts en nature plus encadrés.
En 2019, les recettes ont grimpé à 145 milliards de Fcfa représentant 24% des recettes budgétaires totales. L’ITIE attribue cette hausse à l’amélioration des processus de collecte, notamment via la digitalisation du système fiscal, qui a permis de réduire les pertes et d’accroître la traçabilité des flux financiers.
La montée en puissance s’est confirmée en 2020, malgré le contexte de la pandémie. L’impôt sur les sociétés pétrolières a alors générée 321,37 milliards de Fcfa, soit 60% de recettes issues des industries extractives. Cette hausse, contre intuitive dans une année marquée par la contraction économique mondiale s’explique selon l’ITIE par la mise en place de nouveaux dispositifs de recouvrement et une meilleure coordination entre la Société nationale des hydrocarbures (SNH) et l’administration fiscale.
La tendance s’est brutalement inversé en 2021. Les recettes pétrolières ont chuté à 139,3 milliards de Fcfa, repliant à 23,64% des recettes fiscales totales. Cette baisse s’explique par le recul des prix mondiaux des hydrocarbures et par un ralentissement de la production locale. Le rapport ITIE pour l’année souligne la fragilité du modèle budgétaire camerounais, encore largement tributaire des fluctuations des marchés pétroliers.
L’année suivante, la remontée des prix du pétrole sur les marchés mondiaux a relancé les recettes. En 2022, les revenus fiscaux pétroliers ont atteint 294,97 milliards de Fcfa soit 26,4% des recettes fiscales totales. L’impôt sur les sociétés pétrolières s’est établi à 207,52 milliards de Fcfa en hausse de 154% par rapport à 2021. La SNH, principal canal de collecte, a reversé 774, 51 milliards de Fcfa au Trésor public, consolidant ainsi les capacités de financement de l’Etat.
Un moteur budgétaire mais un source d’instabilité
L’analyse de l’ITIE montre que, sur 5 ans, la fiscalité pétrolière est resté le principal levier fiscal du secteur extractif, mais également l’un des plus instable. Les périodes de forte croissance, tirés par la hausse des cours mondiaux, alternent avec les phases de contractions brutales. Pour les finances publiques camerounaises, cette dépendance structurelle rend la prévision budgétaire particulièrement complexe.
Sur le plan macroéconomique, les contributions du secteur extractif ont également varié. Entre 2018 et 2022, la part du secteur dans le PIB est passé de 2,2% à 6,29% tandis que sa contribution aux recettes d’exportation a atteint 41% en 2022. Pour l’ITIE, les résultats enregistrés illustrent la capacité du Cameroun à améliorer la gestion de ces revenus extractifs grâce à des réformes fiscales et à la transparence accrue du secteur. Mais la dépendance aux hydrocarbures reste un facteur de vulnérabilité. L’organisation recommande d’accélérer la diversification des recettes publiques et d’introduire des instruments de fiscalité vertes, tels que des crédits d’impôts pour les énergies renouvelables ou des exonérations ciblées pour les investissements bas-carbone.
Ces mécanismes, déjà testés dans plusieurs économies productrices, visent à accompagner la transition énergétique tout en stabilisant les recettes budgétaires. A long terme, ils pourraient réduire l’exposition du Cameroun aux cycles pétroliers internationaux et renforcer la soutenabilité des finances publiques.
Le rapport souligne enfin le rôle de la transparence dans la consolidation budgétaire. En documentant les paiements, transferts et taxe du secteur pétrolier, ces rapports permettent d’évaluer la performance réelle du dispositif fiscal et d’identifier les marges de progrès. Pour un pays producteur de pétrole de taille moyenne comme le Cameroun, cette démarche reste essentielle pour anticiper les chocs externes et préparer la mutation de son modèle économique vers des sources de revenus plus stables et durables.