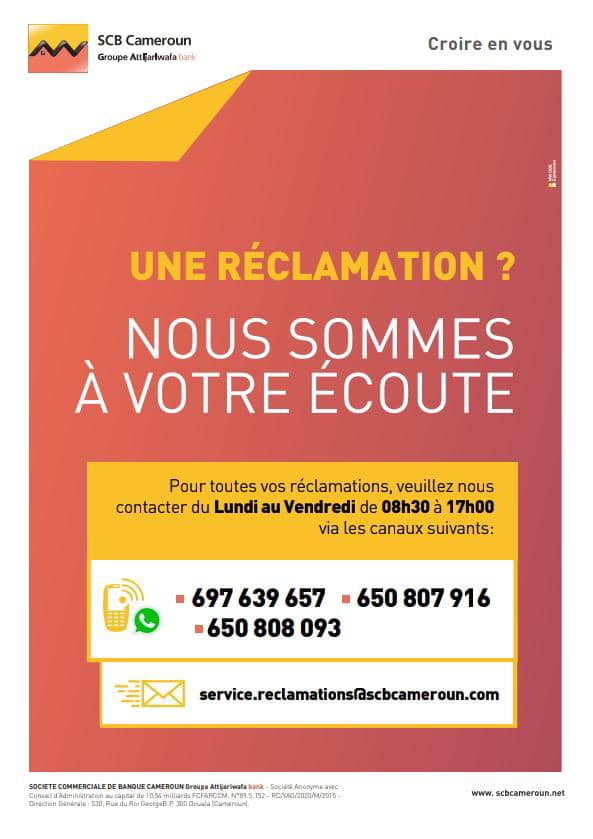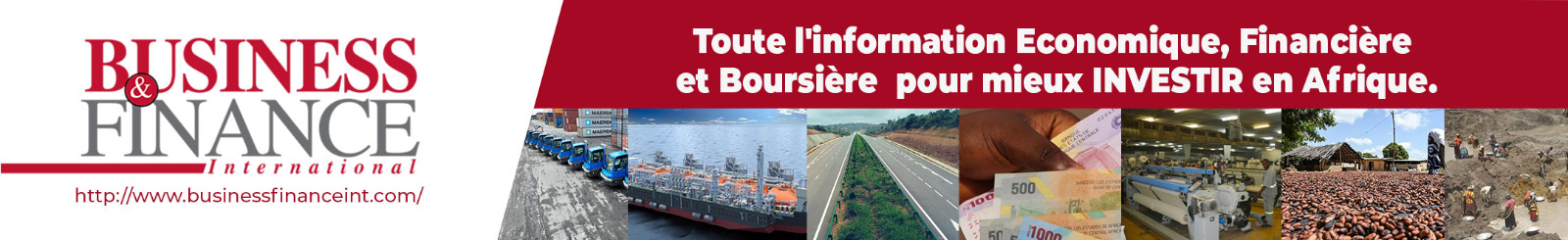(BFI) – Une crise silencieuse couve dans le secteur pétrolier camerounais relaie Investir au Cameroun. Selon des sources au ministère de l’Eau et de l’Énergie, le Groupement des professionnels du pétrole (GPP) — qui regroupe les principaux distributeurs comme TotalEnergies, Tradex, Neptunes Oil, Ola Energy, Gulfcam et Corlay Cameroun — a décidé qu’à compter du 1ᵉʳ novembre 2025, « les membres du GPP envisagent de ne plus acquérir de produits auprès des importateurs non-membres du Groupement ».
Une décision assimilée à un ultimatum, révélatrice du malaise autour de la répartition des quotas d’importation de carburant. Le 2 octobre 2025, le GPP a adressé une correspondance à Okie Johnson Ndoh, directeur général de la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH) et président du Comité ad hoc des importations de produits pétroliers. Dans cette lettre, le groupement présidé par Antoine Ndzengue dénonce « l’exclusion des membres du GPP de l’activité d’importation » au profit « d’importateurs opportunistes ».
Selon le document consulté par Investir au Cameroun, les membres du groupement ont été écartés de l’importation d’essence Super pendant les cinq derniers mois de l’année 2025 et ne détiennent que 3,62 % des volumes de gasoil, alors qu’ils contrôlent 73 % du marché du Super et 78 % de celui du gasoil. Une disproportion que le GPP juge inacceptable. « Ces données établissent de manière irréfutable la mise à l’écart des membres de notre Groupement relativement à l’activité d’approvisionnement du Cameroun en produits pétroliers », affirme le GPP.
Selon le groupement, la situation profite à de nouveaux importateurs, peu implantés localement, accusés de ralentir la distribution et d’occuper durablement les infrastructures de stockage. Les distributeurs historiques, qui détiennent 75 % du marché national et exploitent près de 600 stations-service, dénoncent un traitement inéquitable. « Au regard de la densité de notre réseau, nous nous serions attendus à bénéficier d’un traitement plus en adéquation avec notre poids économique », précise la lettre.
La tension actuelle trouve ses origines dans la libéralisation des importations décidée en décembre 2023. À cette date, le président Paul Biya, via une instruction du Secrétaire général de la Présidence Ferdinand Ngoh Ngoh, avait ordonné d’ouvrir le marché à de nouveaux importateurs. « Procéder à la libéralisation des importations des produits pétroliers », indiquait le courrier présidentiel.
La CSPH fut chargée d’attribuer les quotas aux opérateurs « techniquement et financièrement aptes ». Cette réforme visait à fluidifier les importations après l’incendie de la Sonara en 2019, qui avait contraint l’État à importer 100 % du carburant consommé.
Pour le GPP, cette libéralisation devait être une avancée. « L’État connaît désormais les niveaux de prime que les traders sont prêts à accepter. On ne pourra plus lui raconter n’importe quoi », affirmait déjà un membre du groupement en 2024.
Mais dans la pratique, le mécanisme a ouvert la porte à de nouveaux acteurs, sans toujours renforcer la transparence. Les sociétés de distribution négocient désormais directement avec les traders internationaux. Elles achètent au prix du marché, souvent supérieur au prix à la pompe fixée par l’État, qui compense la différence sous forme de subvention. Quand les cours mondiaux montent, le différentiel entre prix réel et prix administré s’élargit. Cette différence constitue un manque à gagner que l’État rembourse — avec retard. Le GPP rappelle qu’il a souvent assuré la continuité de l’approvisionnement malgré les pertes subies. « Lorsque les cours mondiaux induisaient des manques à gagner, le GPP était en première ligne pour garantir la disponibilité des produits. Le retard de remboursement par l’État a généré de substantielles pertes financières pour plusieurs de nos entreprises », affirme le groupement.
Une équation économique et politique
À l’origine pensée pour simplifier le marché, la libéralisation crée désormais de nouvelles frictions. Selon un haut responsable du Minee, « le gouvernement cherche un équilibre entre ouverture du marché et stabilité de la distribution ». Mais sur le terrain, les majors pétrolières dénoncent des pratiques opaques.
La menace de boycott du GPP reste suspendue, mais la tension demeure. « Si la répartition des quotas n’est pas revue, le système risque l’asphyxie », prévient un analyste pétrolier. Les discussions entre la CSPH, le Minee et le GPP se poursuivent pour éviter toute rupture d’approvisionnement. Autant dire que derrière ce bras de fer technique, c’est bien la sécurité énergétique du Cameroun qui se joue, dans un contexte de pression budgétaire et de crise post-électorale aux conséquences économiques incalculables.
Avec Investir au Cameroun