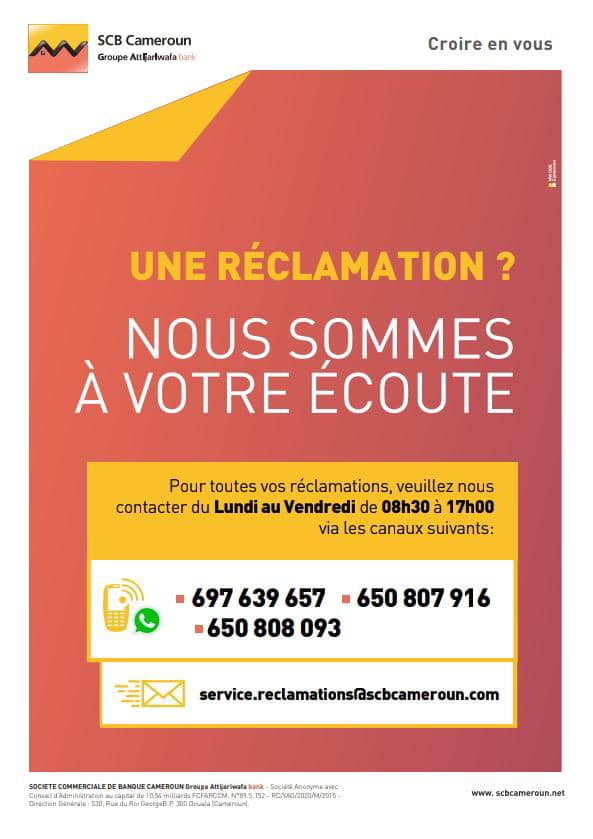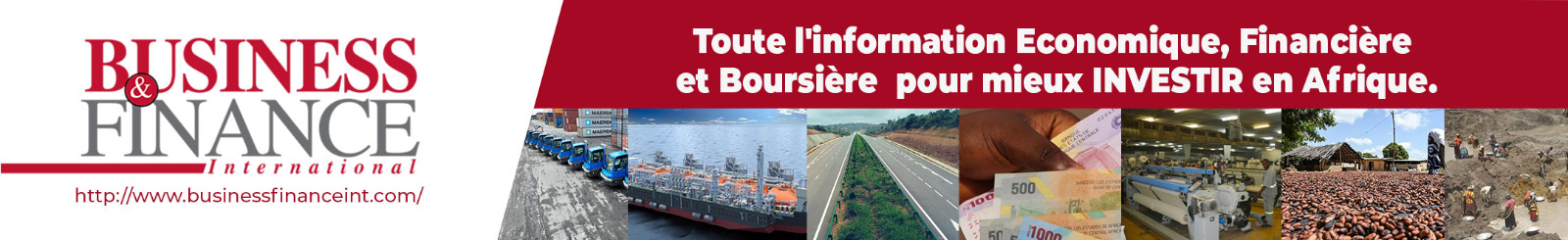Deux possibilités s’offrent aux auteurs d’un coup d’Etat : soit ils se « civilisent », soit ils transfèrent le pouvoir aux civils. L’Etat de l’Afrique 2025 indique que les militaires au pouvoir dans le Sahel ont opté pour une voie inédite : se maintenir au pouvoir sans se « civiliser ». Une situation qui interroge et que l’auteur décrypte sous le prisme conceptuel du « dilemme sahélien ».
Dans L’Etat de l’Afrique 2024, Maurice Simo Djom (Photo) avait baptisé de « châtiment géopolitique » cette détermination des grandes puissances, depuis 220 ans, à appauvrir, déstabiliser, fragiliser Haïti où, pour la première fois, l’homme « noir » a dit non et a vaincu l’horreur de YOVODAH. L’auteur fait partie des panafricainistes qui popularisent ce terme issu de la langue fon au Benin. Cela signifie mot pour mot « la cruauté du blanc ». Le terme YOVODAH est employé pour désigner les affres de la barbarie européenne entre le 16ème et le 20ème siècle).
L’analyse de YOVODAH sous le prisme conceptuel du « châtiment géopolitique » visait à encourager la solidarité transnationale entre le continent et ses diasporas. L’auteur appelait les Africains du continent à ne jamais oublier Haïti, cette terre peuplée par les nôtres, qui sont partis d’Afrique, et qui ont refusé, en 1791 et en 1802, la soumission, qui ont vaincu la barbarie française. S’ils paient pour avoir osé, écrit Maurice Simo Djom, ils paient aussi pour avoir ouvert le chemin de la dignité africaine. Aujourd’hui, les combats des Africains partout dans le monde sont favorisés par ce geste inaugural, cette victoire primordiale qui avait montré que tout est possible.

Autre édition, autre créativité conceptuelle
La créativité terminologique de Maurice Simo Djom a offert un autre concept, avec la parution de L’Etat de l’Afrique 2025. Il s’agit du « dilemme sahélien ». Il se rapporte à la situation politique du Mali, du Niger et du Burkina Faso : des pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir suite à des coups d’Etat. Si la présence des militaires à la tête des institutions se justifie par des conjonctures sécuritaires et sociales qu’il fallait débloquer, le prolongement de leur bail est une ambiguïté. Surtout que ces militaires entreprennent des projets de refondation sociale et culturelle voire économique et monétaire, engageant sans complexe leurs pays respectifs dans des horizons confédéraux qui relèvent d’une vision particulière et de longue haleine.
Maurice Simo Djom note que si les militaires organisent des élections et transmettent le pouvoir à des civils, ces derniers pourraient ne pas partager la vision politique si particulière instaurée après les coups d’Etat. Ils pourraient aller jusqu’à détricoter les engagements tels que l’adhésion à l’AES, la sortie de l’OIF ou de la CIJ. Donc, la meilleure option serait le maintien du pouvoir. Toutefois, en rendant compte de cette situation, l’auteur note aussi que les choses ne sont pas aisées. Se maintenir au pouvoir pourrait relever de la gageure. Les militaires sont sous pression de divers groupes internes et externes qui exigent des élections et le retour à l’ordre constitutionnel. En plus des élections, le peuple demande des succès militaires et économiques, toutes choses qui ne sont pas certaines d’être garanties sur le long terme, le contexte étant difficile à manœuvrer.
Face à ces pressions politiques et sociales diverses, à la fois internes et externes, les militaires ont donné le ton : pour protéger la révolution et opérationnaliser la refondation, ils sont tentés par le totalitarisme que Marie-Anne Matard-Bonucci comme « une idéologie visant à établir un régime politique dont le but est de transformer en profondeur non seulement la société mais aussi l’individu en employant tous les moyens possibles pour atteindre ce but ».
Cela implique que les élections ne sont pas au rendez-vous et que la transition militaire pourrait se poursuivre dans un horizon plutôt élastique, de façon à opérer les ruptures profondes. Cette attitude politique que le reste de la société oppose aux militaires, l’auteur désigne cela par un autre concept : « le fétichisme électoral », en tant qu’elle renvoie à la croyance qu’une élection suffit pour résoudre tous les problèmes d’une société, de quelque nature qu’il soit.
En clair, entre le fétichisme électoral et la volonté de refondation sociale et politique, le cœur des militaires balance. C’est pour cela que le géopolitiste décrit le dilemme sahélien en ces termes : « Si les révolutionnaires suivent la voie du libéralisme politique et social, ils échoueront à transformer la société de fond en comble car ils préserveront, en même temps, les équilibres apparents et les tares congénitales d’une société à la dérive. Mais, s’ils veulent transformer la société de fond en comble, ils pratiqueront le totalitarisme et se mettront à dos une bonne majorité d’un peuple extraverti et poreux dans un contexte d’hyper-médiatisation et d’interconnexion tous azimuts. »
Que feront les militaires au pouvoir dans l’AES sur le long terme ? Bien malin qui y répondra. Toujours est-il que l’auteur souligne la difficulté à refaire le modèle nord-coréen qui réussit dans le contexte du repli radical : « […] le contexte de l’interpénétration des peuples et des économies incline à l’ouverture, à la tolérance et aux échanges. Le référentiel du monde alentour professe une image précise, bien que manipulée, de la démocratie et de l’économie libérale. Il est dès lors difficile de pratiquer un référentiel différent basé sur le centralisme, le contrôle et le dirigisme… »
Or, c’est ce référentiel que tentent de construire les militaires pour faire évoluer leurs pays d’une situation de vassalisation géopolitique vers un horizon de souveraineté et d’autodétermination. On le voit à travers la rupture des liens léonins avec la puissance néocoloniale, mais aussi à travers les emprisonnements des acteurs politiques qui ne sont pas alignés sur les vues de la révolution, l’instauration des modèles de gouvernance orientées vers la discipline, les options de rupture avec l’obésité institutionnelle, avec notamment la réduction du nombre de parts politiques, etc.
Si les militaires réussissent le projet de dévassalisation et de refondation politique de leurs pays respectifs, l’histoire leur revaudra cela. Mais encore faudrait-il qu’ils aient le temps de le faire, vu la pression qu’ils subissent.
Cette quête de sens et de profondeur devient progressivement la marque de fabrique de L’Etat de l’Afrique, une revue annuelle de géopolitique lancée en 2023 par Maurice Simo Djom qui ambitionne à la longue de créer une « perspective africaine de l’Afrique et du monde ». La deuxième parution, celle de 2025, est encore entièrement rédigée par le créateur qui promet toutefois que dès 2027, la revue sera désormais un ouvrage collectif. En analysant les faits de façon froide, sans préjugé, mais avec intégrité intellectuelle, la revue veut faire de l’Afrique un objet scientifique et non plus un sujet fantasme et de paternalisme.