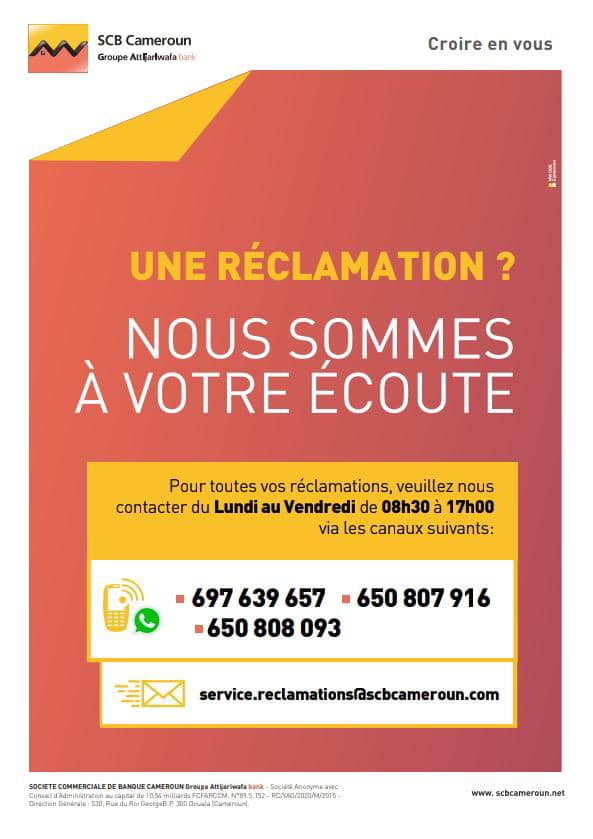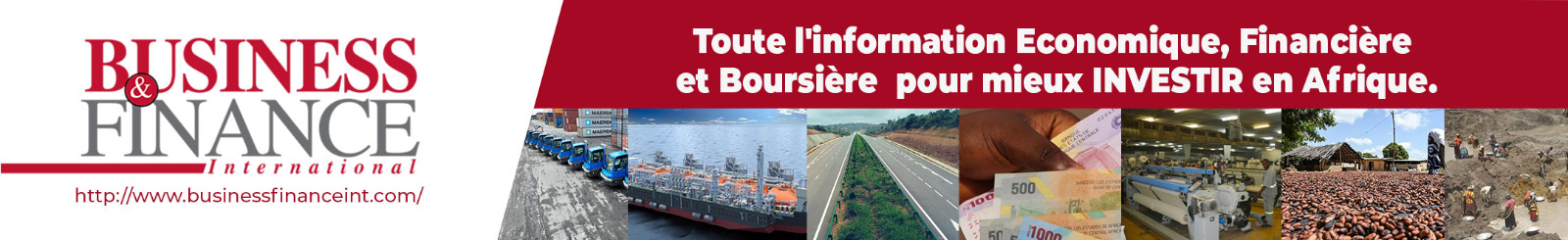(BFI) – La lutte contre la contrebande s’avère cruciale au Cameroun, où elle impacte l’économie et la santé publique. Situé à la croisée de multiples frontières, le pays est particulièrement exposé aux activités illicites. La récente saisie de 131 cartons de whisky, 16 cartons de vin et 10 palettes de bière par la Brigade Mobile des Douanes d’Ambam, le 2 octobre 2025, illustre ces défis. Ces produits, introduits clandestinement depuis la Guinée Équatoriale, soulèvent des préoccupations sur les risques liés à la consommation de boissons non certifiées, potentiellement nuisibles à la santé des consommateurs.
La contrebande ne se limite pas à l’évasion fiscale. Elle engendre aussi des conséquences graves pour la santé publique. Les produits non réglementés échappent aux contrôles de qualité, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires. Les consommateurs, souvent mal informés, ignorent les risques qu’ils encourent.
En outre, la contrebande représente un manque à gagner pour l’État. Les taxes sur les boissons alcoolisées constituent une source de revenus essentielle, et leur évasion nuit gravement à la capacité de l’État à financer des services publics. Ainsi, la lutte contre cette pratique est devenue une priorité incontournable pour les autorités camerounaises.
Les défis opérationnels des autorités douanières
Les autorités douanières font face à de nombreux défis opérationnels dans leur combat contre la contrebande. La surveillance des frontières s’avère complexe, souvent entravée par des ressources limitées. Les agents doivent couvrir de vastes zones, rendant difficile la détection des activités illégales. Bien que la saisie récente de boissons alcoolisées soit le fruit d’une vigilance accrue, cela reste l’exception.
Par ailleurs, la corruption au sein des forces de l’ordre complique encore la situation. Certains agents peuvent être tentés d’accepter des pots-de-vin, favorisant ainsi l’impunité. Ce phénomène engendre un climat où la contrebande peut prospérer, rendant les efforts des autorités d’autant plus ardus. Des études montrent que la corruption dans les douanes est un problème largement répandu dans de nombreux pays en développement, y compris le Cameroun.
Enfin, la coopération entre les différents acteurs est cruciale pour lutter efficacement contre la contrebande. Les autorités douanières doivent collaborer avec d’autres agences gouvernementales et des acteurs privés pour établir un réseau de surveillance opérationnel. Toutefois, cette coopération est souvent entravée par des silos institutionnels et un manque de communication entre les entités.
Vers une sensibilisation accrue et une coopération renforcée
Pour surmonter ces défis, il est fondamental d’augmenter la sensibilisation du public et des acteurs économiques. Les autorités douanières insistent sur l’importance de la vigilance au sein de la population. Informer le public sur les dangers des produits non réglementés peut réduire la demande. Des campagnes de sensibilisation pourraient jouer un rôle clé dans cette lutte.
La coopération internationale se révèle également essentielle. Étant donné que le Cameroun partage des frontières avec plusieurs pays, une approche régionale pourrait être utile. Des accords bilatéraux visant à renforcer la surveillance aux frontières pourraient réduire considérablement le flux de produits illicites. Des succès observés dans d’autres régions du monde montrent que la coopération transfrontalière est un outil efficace contre la contrebande.
En somme, la lutte contre la contrebande nécessite une approche multidimensionnelle. Cela inclut la sensibilisation, la coopération et le renforcement des capacités des autorités douanières. Bien que les défis soient nombreux, une volonté politique forte et un engagement collectif peuvent créer un environnement commercial plus sûr et mieux régulé.
Face à ces enjeux, il est légitime de se demander : quelles mesures concrètes peuvent être mises en place pour améliorer la lutte contre la contrebande au Cameroun ? Comment impliquer davantage la société civile dans cette bataille ? Les réponses à ces questions pourraient façonner l’avenir du commerce légal dans le pays.
Omer Kamga