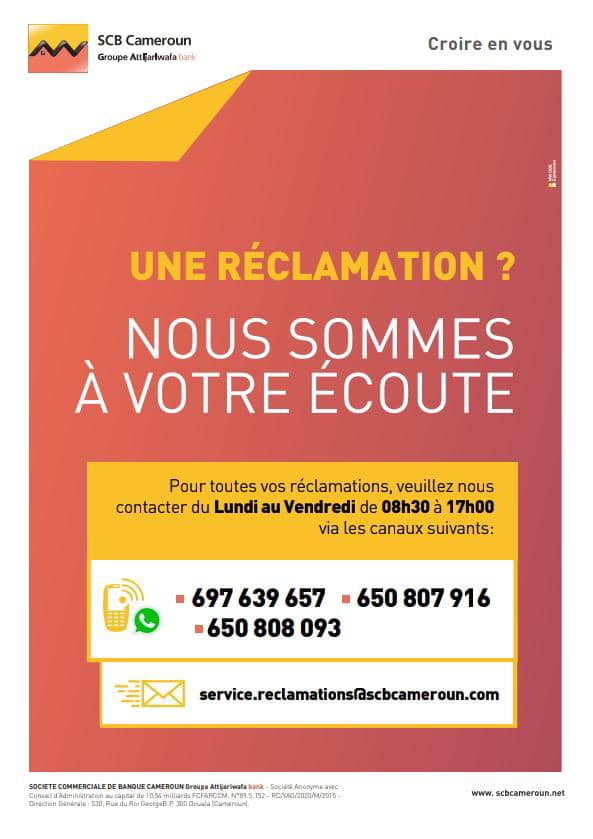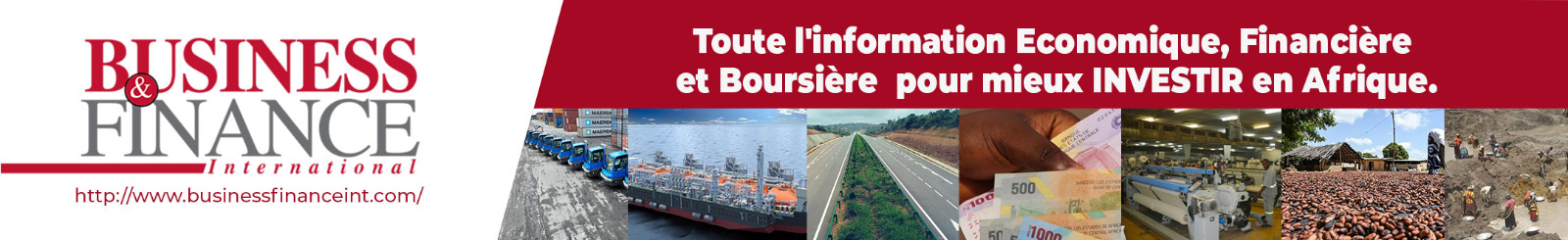(BFI) – En sommet à Kinshasa, les pays africains s’emploient à relancer le commerce intra-africain à travers la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale.
L’Accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) a été signé à Kigali (Rwanda) le 21 mars 2018, lors d’un sommet de l’Union africaine. Sept ans après son adoption, la ZLECAf avance à pas mesurés. Son objectif reste clair : stimuler les échanges commerciaux entre pays africains, en favorisant la libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Mais sur un continent où le commerce intra-africain ne représente que 15 % des échanges – contre 70 % en Europe et 50 % en Asie – le défi est immense.
Réunis cette semaine à Kinshasa, les représentants des États membres tentent de faire le point sur les avancées, tout en identifiant les freins structurels à lever. Parmi les priorités : diversifier les économies africaines, développer les chaînes de valeur régionales, améliorer les infrastructures et garantir l’accès à l’électricité. Des chantiers lourds, notamment pour la République démocratique du Congo, pays hôte de la réunion, qui dispose d’immenses ressources naturelles mais accuse encore un important retard en matière d’équipements et de connectivité. Pour l’instant, seuls huit pays participant à l’initiative dite de « commerce guidé », ont mis en oeuvre la phase pilote de l’accord. Le Ghana, le Rwanda, le Kenya ou encore la Tunisie ont déjà échangé 96 produits dans ce cadre, respectant à 90 % les règles d’origine établies par la ZLECAf.
Selon Mounirou Alioune Kane, coordinateur des recherches au Centre Africain pour le Commerce, l’Intégration et le Développement (ENDA-CACID), basé à Dakar au Sénégal, la mise en oeuvre est volontairement progressive « Non seulement c’est voulu, mas c’est stratégique et c’est aussi planifié. Ces huit Etats faisaient partie de la première phase de l’initiative sur le commerce guidé. Il s’agit d’un instrument adopté par les chefs d’Etat et le secrétariat de la ZLECAf pour tester l’opérationnalisation concrète de la zone de libre-échange », a-t-il déclaré.
Des obstacles persistants
Malgré ces avancées, plusieurs obstacles restent à surmonter : complexité des procédures douanières, faible accompagnement du secteur privé, lenteurs administratives, sans oublier les barrières non tarifaires, encore trop nombreuses.
Autre difficulté : les disparités entre les communautés économiques régionales. « Ce ne sera pas de tout repos. On a des Etats à des niveaux de développement très différents, des niveaux d’intégration très disparates. Si vous comparez aujourd’hui la Cédéao et l’Union du Maghreb Arabe, vous verrez que des considérations géopolitiques et stratégiques influencent fortement leur degré d’intégration, et cela peut affecter le fonctionnement de la Zlecaf », a expliqué Mounirou Alioune Kane. Alors que la ZLECAF prône l’intégration économique continentale, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO interroge. Cette organisation sous-régionale était pourtant censée être une rampe de lancement pour le libre-échange. Mais là encore, les experts relativisent : « L’accord ZLECAF a été négocié individuellement par les États, pas par les communautés régionales. Ce retrait n’empêche donc pas la poursuite du processus », a précisé le chercheur sénégalais.
Contexte mondial tendu
En toile de fond, le commerce mondial traverse une période d’instabilité. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s’intensifie. Le président Donald Trump a récemment imposé des droits de douane de 145 % sur les produits chinois. Pékin a répliqué avec des taxes de 125 % sur les importations américaines. Cette escalade perturbe déjà les chaînes d’approvisionnement globales et impacte les marchés financiers. L’Afrique, bien qu’encore marginale dans ces échanges, n’est pas totalement à l’abri des effets collatéraux de ces tensions commerciales mondiales.